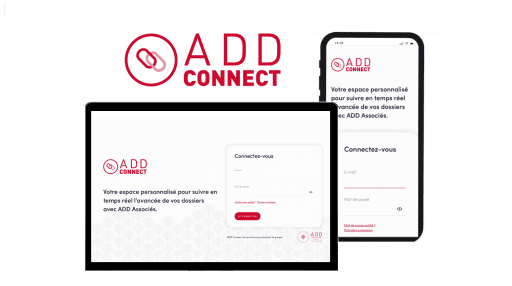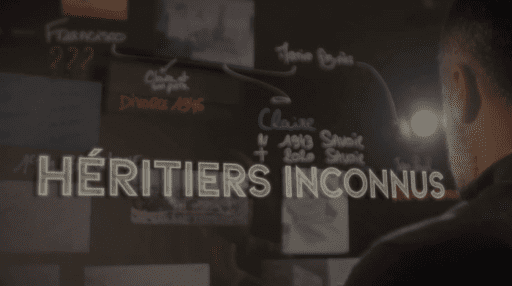ADD Associés, la référence de la généalogie successorale
Parce qu'hériter
est un droit






Rechercher un héritier est bien plus qu’un enjeu de patrimoine. C’est aussi une question de droit, d’équité, de prise en compte de l’humain et de compréhension de la société dans toutes ses mutations.
Rechercher, Révéler, Représenter
ADD Associés et la généalogie successorale, une histoire d’expertise et de passion
Créé en 1990 avec la volonté de dynamiser le marché de la généalogie successorale par un investissement fort dans l’humain, l’international, l’expertise juridique et les nouvelles technologies, le groupe ADD est aujourd’hui un partenaire de confiance et une référence mondiale.
Plus sur ADD Asocciés- 170 Professionnels experts
- 33 Bureaux dans le monde
- 33 Ans d'expérience
- 4 Garanties fortes
Vous êtes un héritier
Vous retrouver, faire valoir vos droits et vous représenter
Notre mission de généalogiste successoral consiste à retrouver des héritiers : les identifier, les localiser, entrer en contact avec eux afin de révéler l’origine de leurs droits héréditaires puis les représenter lors de la liquidation de la succession.
Vous avez été contacté par notre équipe de généalogistes successoraux car vous avez été identifié comme héritier.
Nos équipes se tiennent à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.

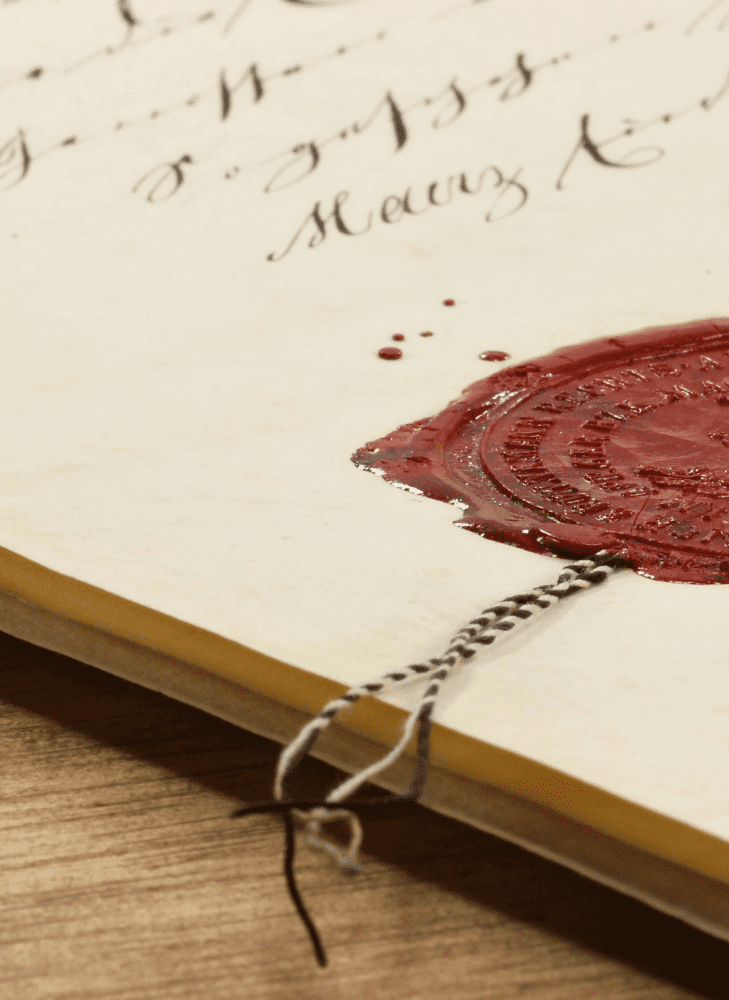
Vous êtes un professionnel
ADD Associés, un partenaire à votre écoute
Nous plaçons la qualité et la réactivité au cœur de la relation que nous tissons avec les professionnels qui nous mandatent.
Ainsi, nous investissons massivement dans l’humain, les technologies et l’international afin de vous assister efficacement dans l'exercice de votre mission en toute confiance et dans un cadre de sécurité juridique.
-

1 interlocuteur unique dédié -

Vos dossiers 24/7 -

+15 000 professionnels nous font confiance -

ADD DATA 500 millions de données indexées -

Des capacités de recherches internationales -

Tableau Généalogique Dématérialisé